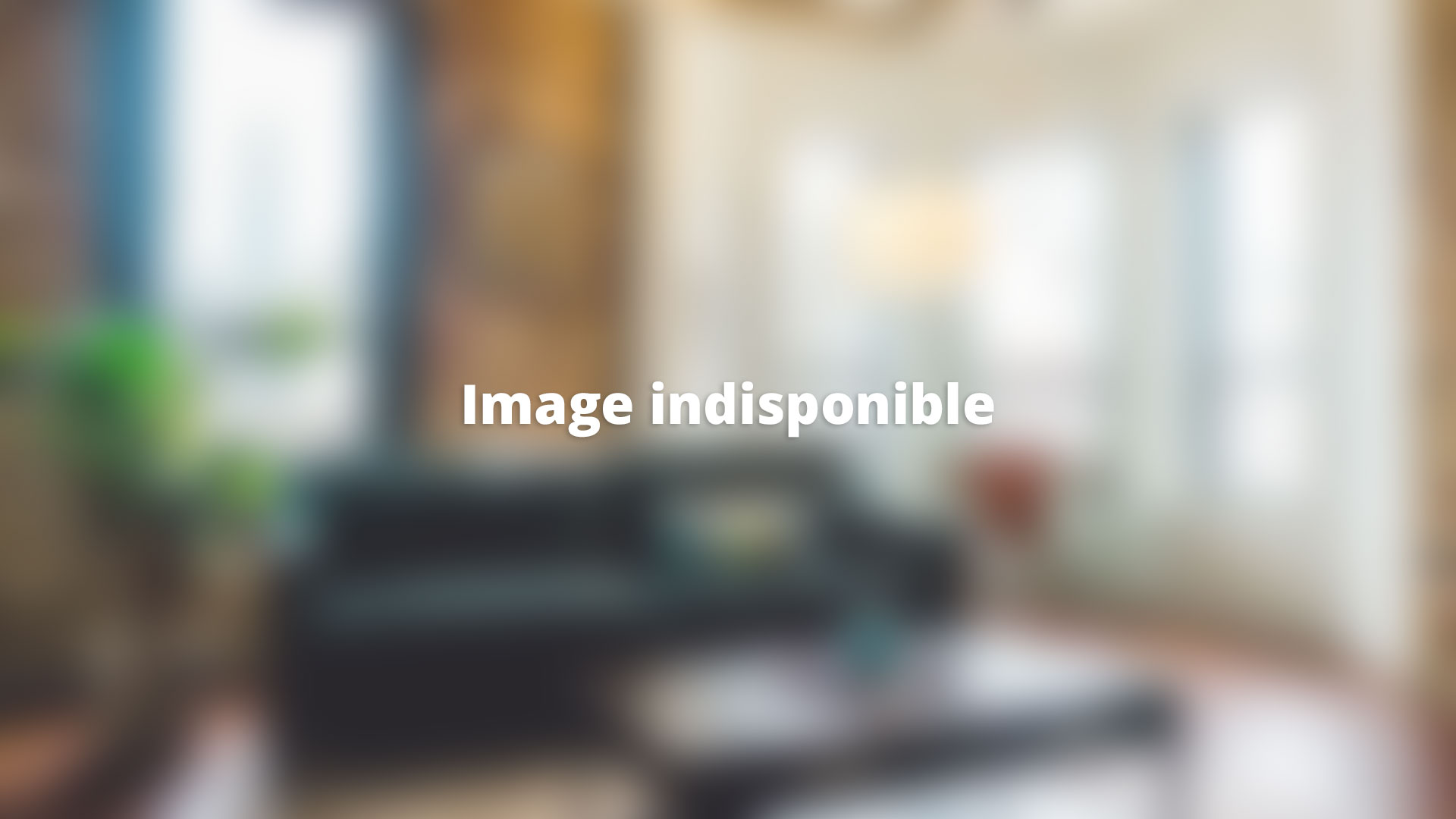
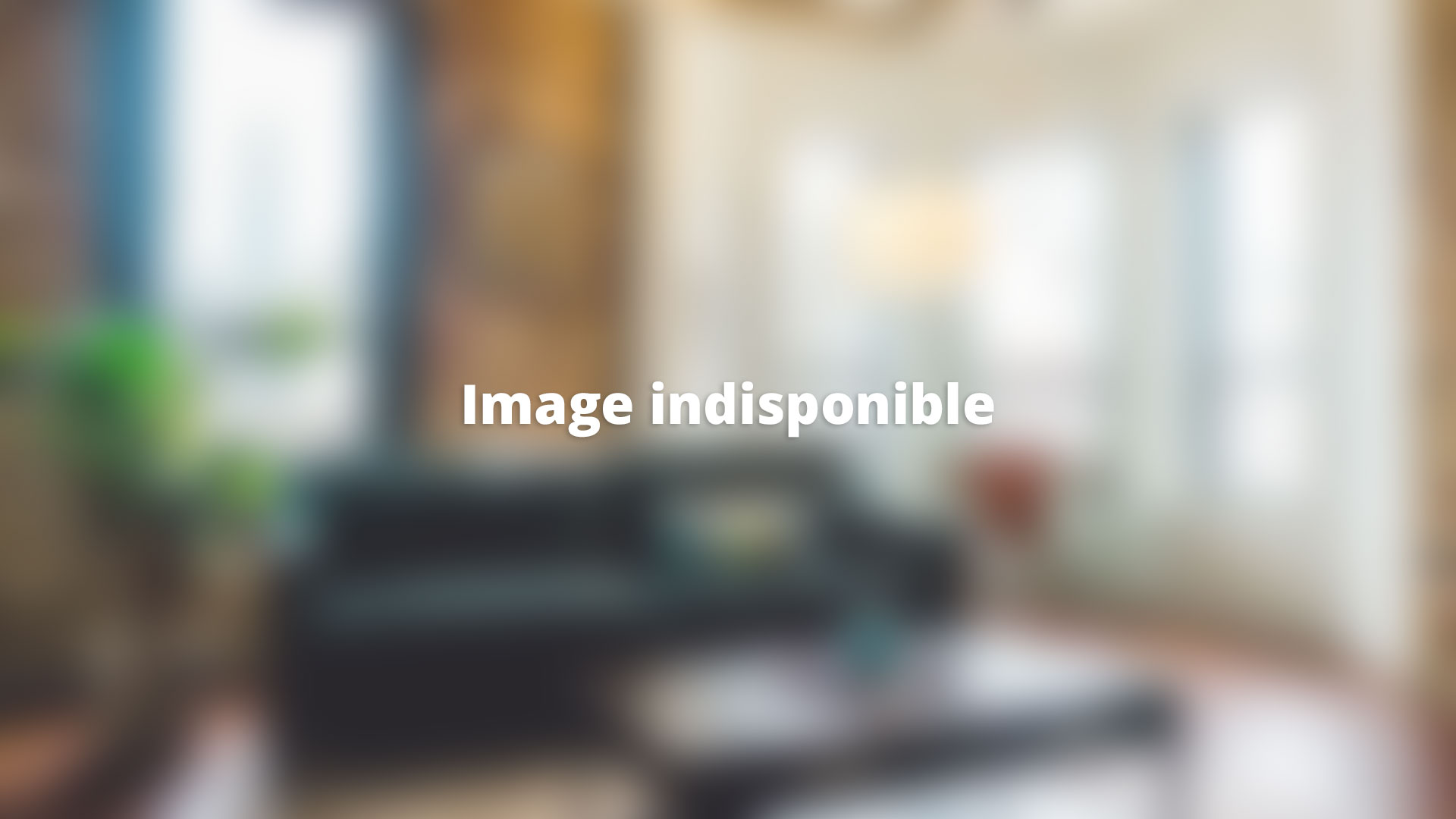
Noté 5 étoiles sur 5 sur Google Maps |
Le quartier est centré sur le campus de l’Université Laval, mais il comprend également d’autres secteurs à vocation résidentielle, commerciale, industrielle et institutionnelle. À ce titre, il constitue un des quartiers les plus variés de la ville de Québec. Il est délimité par les rues suivantes :
Le territoire est d’abord inclus dans la seigneurie de Sillery, concédée en 1651 aux Hurons-Wendat, sous la tutelle des Jésuites de Kamiskoua-Ouangachit. Le peuplement débute dans les années 1660. Une chapelle d’écorce destinée aux Amérindiens et aux colons français est bâtie en 1667 à l’angle du chemin des Quatre-Bourgeois et de l’autoroute Robert-Bourassa. À partir de 1673, les Hurons-Wendat quittent l’endroit pour Lorette. Le secteur dit de « Côte Saint-Michel » est défriché le long du chemin Sainte-Foy (alors désigné Saint-Michel). La mission Notre-Dame-de-Foy, établie au coin de la route de l’Église et du chemin Sainte-Foy, est érigée en paroisse dès 1678 par François de Laval. C’est à cet endroit, situé à l’extrémité ouest actuelle du quartier, que le village de Sainte-Foy prend racine.
Jusqu’au XXe siècle, ce secteur de Sainte-Foy a une vocation purement agricole. Progressivement, l’étalement urbain de Québec fait naître certaines institutions au milieu de cette zone rurale : le cimetière Notre-Dame-de-Belmont (1859), l’hôpital Laval (1918), l’Institut Saint-Jean-Bosco (1923) et le pavillon Montcalm (1925). En 1947, l’Université Laval est à l’étroit dans ses bâtiments ancestraux du Vieux-Québec et prévoit ses problèmes s’aggraver avec le boom démographique de l’Après-guerre. L’urbaniste Édouard Fiset réalise une étude préliminaire sur la création d’une vaste cité universitaire à Sainte-Foy. Le projet se met en branle rapidement. Dès 1950, le pavillon Abitibi-Price est érigé et devient le premier d’une longue série de bâtiments à voir le jour sur ce site.
Les années 1950 et 1960 voient véritablement sortir le quartier de terre. En parallèle du chantier du campus, le reste du territoire est quadrillé de rues résidentielles où s’alternent bungalows et immeubles d’appartements. Ce grand ensemble possède des caractéristiques architecturales répétitives et témoigne de la rapidité de l’urbanisation de la Cité-Universitaire. Cette explosion démographique fait naître plusieurs centres commerciaux dont Place Laurier (1961), au sud-ouest, et la Pyramide de Sainte-Foy (1975), au nord. Le quartier confirme son identité de « cité étudiante » avec l’arrivée des cégeps François-Xavier-Garneau, Sainte-Foy et Champlain St. Lawrence au tournant des années 1970. En raison de la circulation automobile générée par la nouvelle cité, l’autoroute Robert-Bourassa est mise en service en 1975, traversant le quartier en son centre dans un axe nord-sud.
Cette effervescence urbanistique finit par s’essouffler à la fin des années 1970, le sol étant entièrement occupé à l’exception de certaines zones du campus de l’université qui sont réservées à la conservation naturelle ou au développement ultérieur. En 2002, la ville de Sainte-Foy est fusionnée à Québec et le secteur devient un quartier au sein de l’arrondissement de Sainte-Foy-Sillery. La Cité-Universitaire est depuis quelques années dans une phase de mûrissement et même de densification. Le nord du campus de l’université voit la construction du Stade TELUS-Université Laval en 2010 et l’agrandissement du PEPS en 2013. Durant cette période, des travaux de réaménagement routier sont opérés dans ce secteur.
Source: Cité-Universitaire, Wikipédia
Consultation gratuite de 30 minutes.
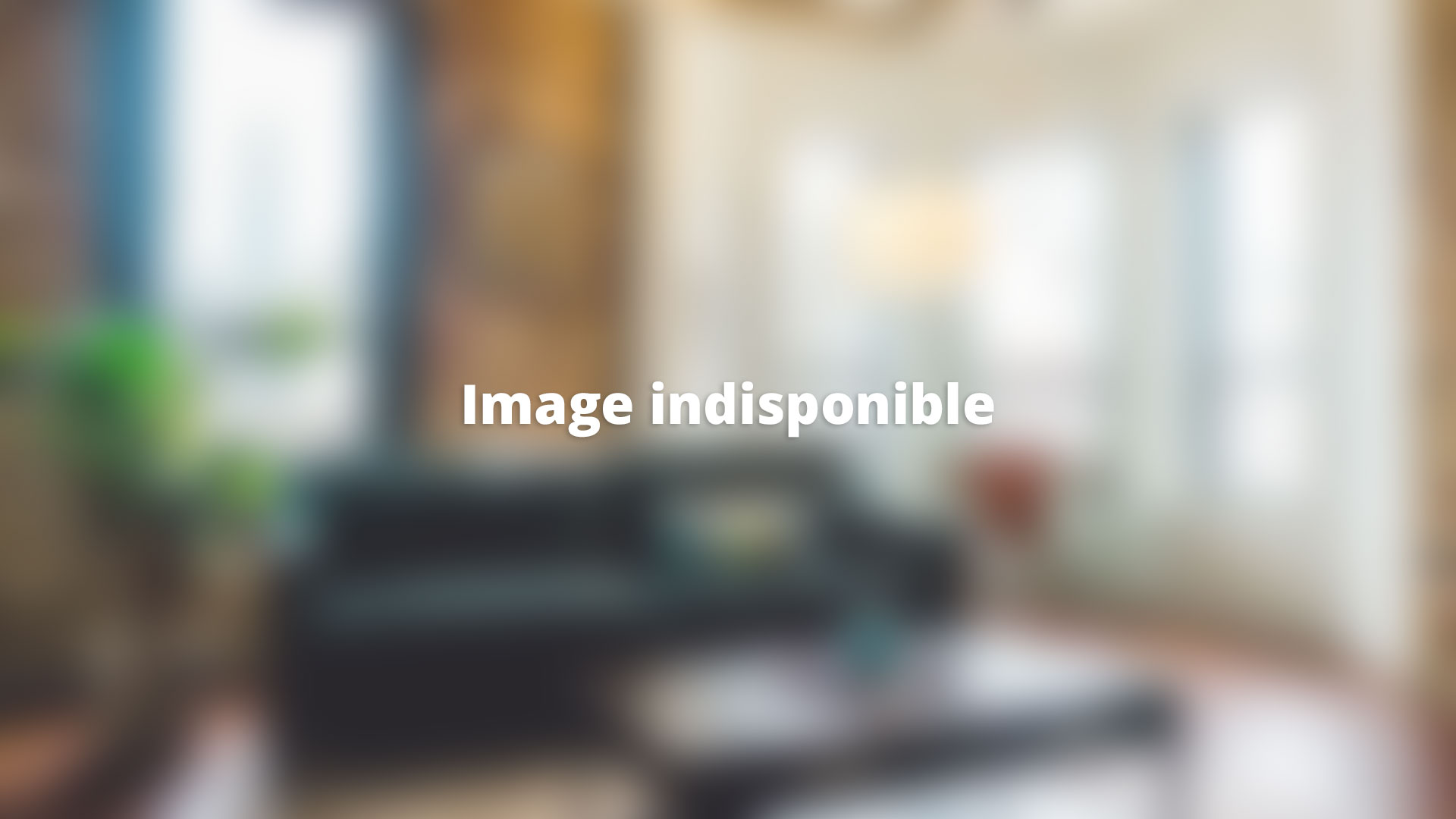
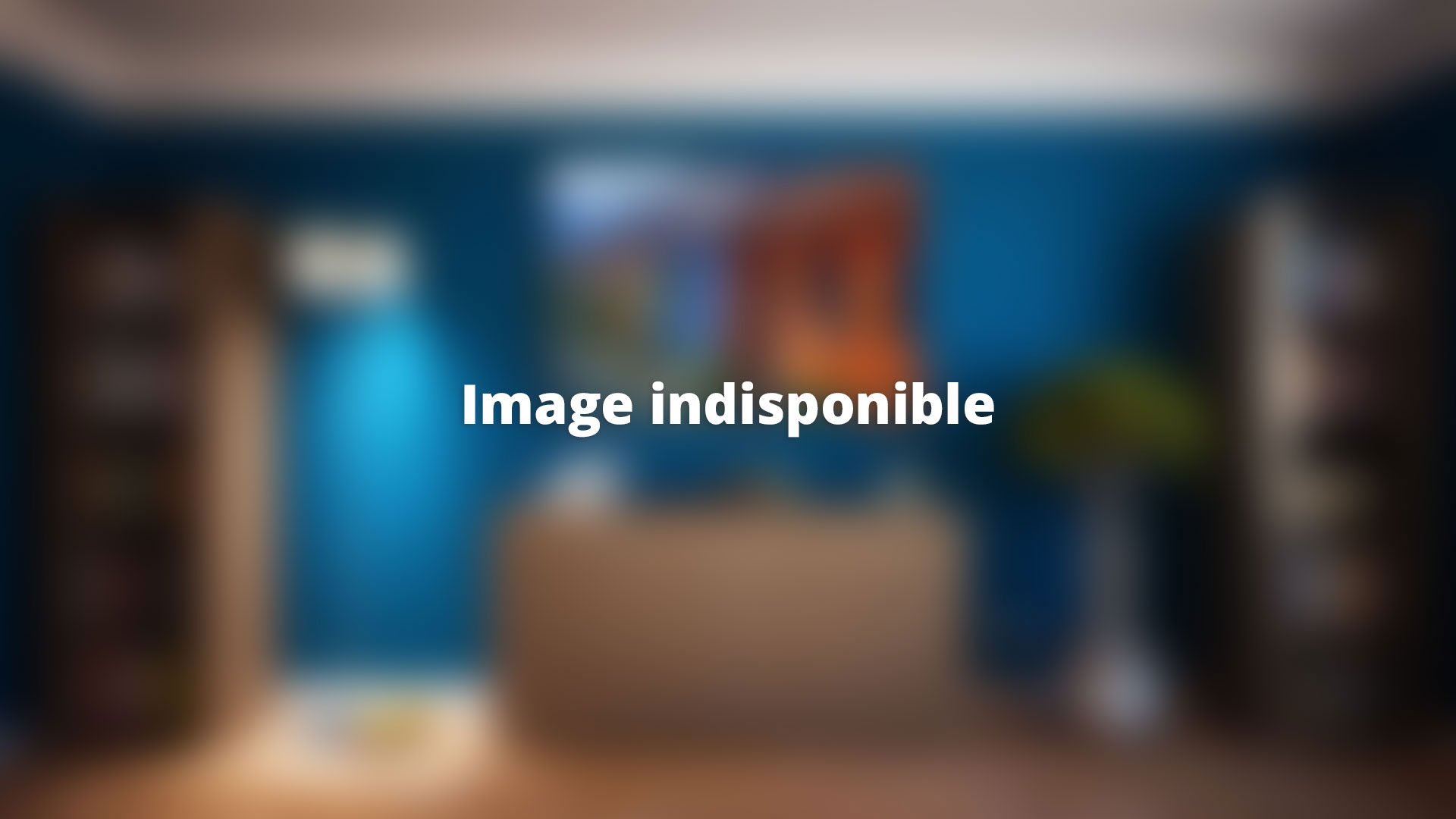
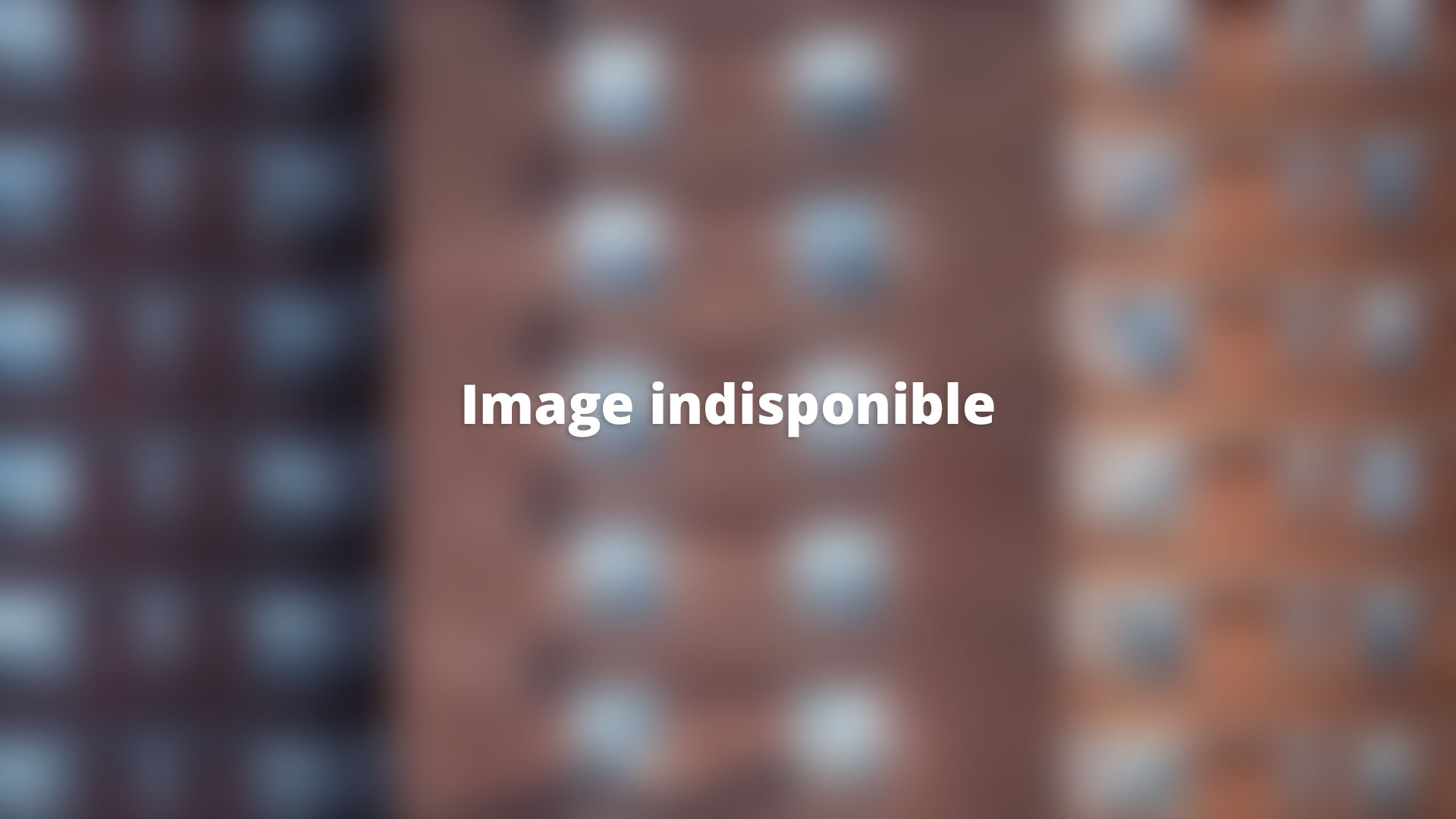
Je suis très accessible et sympathique. N’hésitez pas à me parler de votre projet immobilier.